Pour que la Suisse parvienne à tenir la cadence des technologies de pointe à l’international, il faut plus de capital-investissement. Dominique Mégret, Head of Swisscom Ventures, explique dans cette interview comment il a l’intention de faire de la Suisse une «Deeptech Nation» à la réussite mondiale.
Dominique Mégret a de grands projets pour les start-up et l’avenir de l’économie helvétique. En investissant 50 milliards de francs de capital-risque dans 5 000 start-up, 100 000 nouveaux emplois doivent voir le jour d’ici 2030. Cela doit permettre à la Suisse d’endosser un rôle de leader économique à l’international en tant que «Deeptech Nation» dans des technologies de pointe. Dans son ouvrage, Dominique Mégret présente dix «moonshots» – des projets d’innovation ambitieux. Tous sans exception concernent des secteurs où la Suisse possède déjà une recherche de premier ordre, comme la médecine de précision avec des applications sur mesure et le sport connecté, mais aussi la durabilité. La démarche consiste à monétiser la recherche avec des offres commerciales, et ce en Suisse.
Les cinq milliards de francs par an de capital-investissement (venture capital, VC) nécessaires représenteraient bien plus que ce que la Suisse investit aujourd’hui dans les start-up. En 2021, le montant s’élevait à trois milliards. Réflexions utopiques du responsable de Swisscom Ventures? Non, nécessité conjoncturelle visant à renforcer et à maintenir la place de la Suisse face à la domination des géants de la tech asiatiques et américains, comme le souligne Dominique Mégret en interview.

Dominique Mégret, la Suisse a-t-elle vraiment une chance face à la Silicon Valley? Un «Google suisse» est-il imaginable?
Pas tellement, car il est difficile de suivre le rythme dans le domaine B2C. Il faut énormément d’argent pour développer les technologies et surtout pour les commercialiser. À titre d’exemple, l’entreprise Uber, qui propose des services de transport, a dépensé à elle seule 30 milliards de dollars américains jusqu’à ce jour. C’est-à-dire le double des dépenses de la Suisse entière ces 30 dernières années (17 milliards de francs dans 2 700 start-up avec 29 000 postes sur le territoire). Dans l’environnement B2B en revanche, dans des niches qui s’appuient sur la recherche scientifique et une propriété intellectuelle puissante, sous forme de brevets et de savoir-faire, nous avons une chance. C’est ce domaine que je nomme Deeptech. Il est important en l’occurrence d’avoir les meilleures hautes écoles pour développer par la recherche de pointe des technologies à un très haut niveau. Dans ce domaine, nous pouvons faire partie des meilleurs au monde. Nous l’avons déjà vu, par exemple en médecine avec la société bâloise Actelion, la plus brillante start-up de biotech de Suisse. Celle-ci a été vendue au géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson pour 30 milliards de francs. Mais aussi en robotique ou en fintech.
Que faut-il pour que ces Deeptechs, comme Ecorobotix, puissent s’imposer à l’échelle mondiale?
Ecorobotix (note de la rédaction: start-up suisse qui parvient à réduire d’environ 90 % l’utilisation de pesticides dans l’agriculture avec des technologies comme l’intelligence artificielle et la 5G) est un bon exemple. Si cette entreprise pouvait se mettre à l’échelle, elle pourrait contribuer à résoudre dans le monde entier des problèmes auxquels l’agriculture est confrontée. Pour ce faire, Ecorobotix a néanmoins besoin d’investissements qui lui permettraient d’engager une activité européenne ou internationale. Et là, nous avons un problème en Suisse. Par le passé, il fallait environ 20 ou 25 ans pour devenir numéro un dans le monde, avec une croissance organique autofinancée et des dettes. Aujourd’hui, des firmes en croissance réussissent à trouver en cinq ans des milliers, voire des milliards de capital-risque, surtout dans les pays anglo-saxons. Et elles se développent donc plus vite que toutes les autres. Dans cette course, nous n’avons pas les mêmes chances. Nous aurions besoin à cet égard de plus de capital-investissement.
«Normalement, les entrepreneurs prospères investissent dans la prochaine génération.»
Dominique Mégret
Il manque donc en Suisse du capital-risque – vous parlez de quelque 5 milliards par an. D’où cet argent doit-il venir?
À l’heure actuelle, près de 80 % du capital-risque provient d’investisseurs internationaux. Il serait bon qu’une plus grande part vienne d’investisseurs suisses. Car si la Suisse finance ainsi la recherche scientifique, elle ne peut pourtant pas profiter de la croissance et de la création de valeur de ces entreprises parce que les gains générés par ces investissements reviennent aux investisseurs internationaux.
Normalement, les entrepreneurs prospères investissent dans la prochaine génération. La Silicon Valley l’a fait et a bâti un écosystème dans lequel une génération soutient la prochaine déjà à un stade précoce. C’est ce dont nous avons besoin aussi en Suisse, et ce à une échelle bien plus importante qu’aujourd’hui. Nous devons accélérer le processus de développement des entreprises en croissance.
Pourquoi la Suisse n’a-t-elle pas réussi à ce jour à augmenter le volume des investissements?
Le volume croît réellement, de quelque 30 % par an depuis dix ans; il est ainsi passé de 300 millions à 3 milliards en 2021. Cependant, nous sommes partis d’un niveau très bas, avec 25 ans de retard sur les États-Unis. Et notre part du marché mondial pour le capital-investissement a stagné à 0,5 %, diminuant même légèrement ces trois dernières années.
Que se passera-t-il si la Suisse ne réunit pas suffisamment de capital-risque?
Dans ce cas, nous n’aurons pas une position assez forte sur les nouveaux marchés, numériques en particulier. L’Europe ne possède que 2 % de l’économie numérique – j’entends par là la capitalisation boursière cumulée de la Big Tech – comparativement aux 83 % des États-Unis. Une position forte serait d’une extrême importance, parce que ce marché, c’est l’avenir. On y trouve par exemple l’industrie des semi-conducteurs, l’ensemble de l’informatique et de la télécommunication et Internet en général.
Mais ce n’est pas le seul secteur où nous perdons du terrain. Les acteurs du numérique révolutionnent des filières industrielles ancestrales, à l’image du secteur automobile, de la branche énergétique ou de l’agriculture. Des start-up financées par du capital-risque bouleversent des secteurs souverains qui constituaient autrefois un monopole étatique, comme l’aérospatial (SpaceX) et la formation (Coursera). Les Européens doivent absolument continuer à développer leur propre écosystème d’innovations pour améliorer leur souveraineté en matière de technologie et de données.
Je dirais même que les innovations technologiques sont indispensables pour préserver notre démocratie dans sa lutte contre les systèmes autocratiques. Même si ceux-ci s’ouvrent au capitalisme libéral, ils ont des difficultés à créer un environnement créatif reposant sur la libre pensée, sans parler d’un écosystème entrepreneurial suffisamment dynamique.
Nous ne pouvons donc que gagner si nous soutenons les entrepreneurs. Il nous faut néanmoins être sélectifs. Nous ne pouvons pas dilapider des ressources pour des activités purement spéculatives. Les ressources en capital financier et humain doivent se concentrer sur le développement de technologies fondamentales (Essential Tech) qui contribuent à résoudre les grands problèmes de l’humanité et de la planète. C’est là un défi captivant pour Swisscom et pour la Suisse.
Deeptech Nation
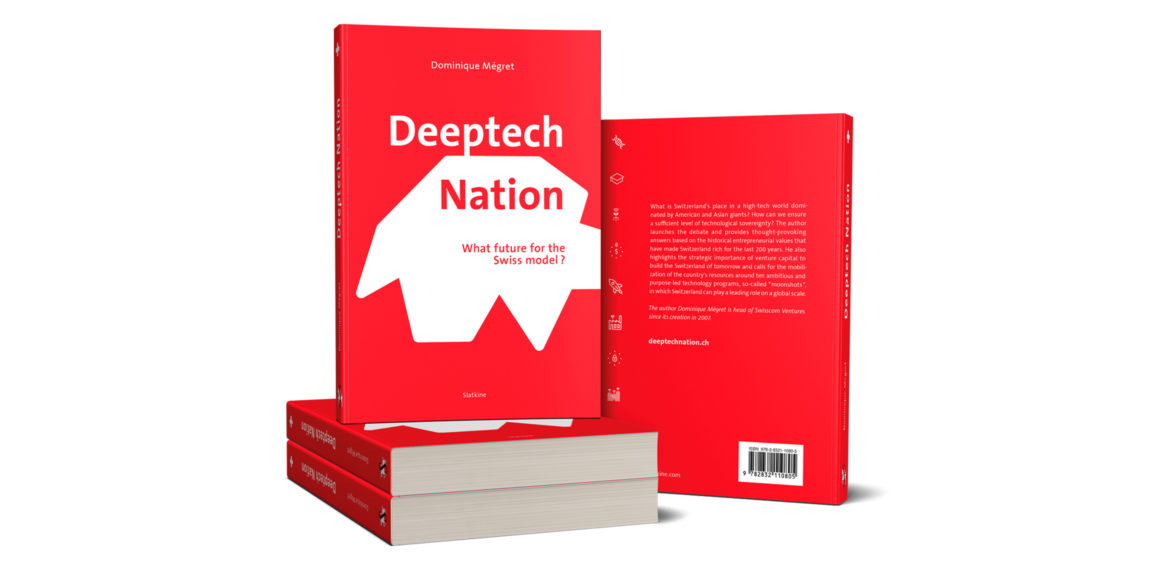
Dans son ouvrage, Dominique Mégret, Head of Swisscom Ventures, s’intéresse au passé des entreprises suisses de la tech, dans différentes branches. Mais l’auteur dresse avant tout un tableau de l’avenir et montre comment l’économie suisse, grâce à des «moonshots» dans un environnement high-tech, peut réussir à se maintenir au firmament. Car les alternatives sont peu réjouissantes.
Dominique Mégret, Deeptech Nation, 320 pages, disponible en allemand, français et anglais, CHF 29.–

